Les valeurs et principes découverts
Une éthique d’entreprise ne sera pleinement humaine et épanouissante que dans la mesure où elle s’inspire des principes fondamentaux de toute éthique :
Reconnaître l’égalité de dignité de toute personne, tous les hommes étant frères, enfants d’un même Père, diront les croyants.
Accorder la priorité à la personne sur les choses et donc sur le capital.
Veiller au bien commun de toutes les personnes à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.
Travailler à la solidarité des travailleurs et avec les travailleurs.
Toute entreprise doit être une société, c’est-à-dire un rassemblement de personnes où chacun se soucie de l’autre. Où chaque personne est en même temps soucieuse de soi et d’autrui. En effet, par nature, chacun est « être pour soi et pour autrui ». Au contraire, dans ce qu’on peut appeler une « dissociété », l’être pour soi est exalté et l’être pour autrui étouffé. Par opposition, dans une hypersociété, l’être pour soi est étouffé et l’être pour autrui exalté. Quant à la société totalitaire, elle étouffe l’être pour soi et l’être pour autrui.[1]
Veiller à la subsidiarité qui marie l’autorité entendue comme capacité, la liberté et la responsabilité.
Permettre l’accès à la propriété grâce à un juste salaire.
Garder le souci de la famille dans l’organisation et la rémunération du travail.
Maintenir la paix sociale par la concertation.
Être ouvert au mystère en respectant les consciences.
N’oublions pas :
La destination universelle des biens
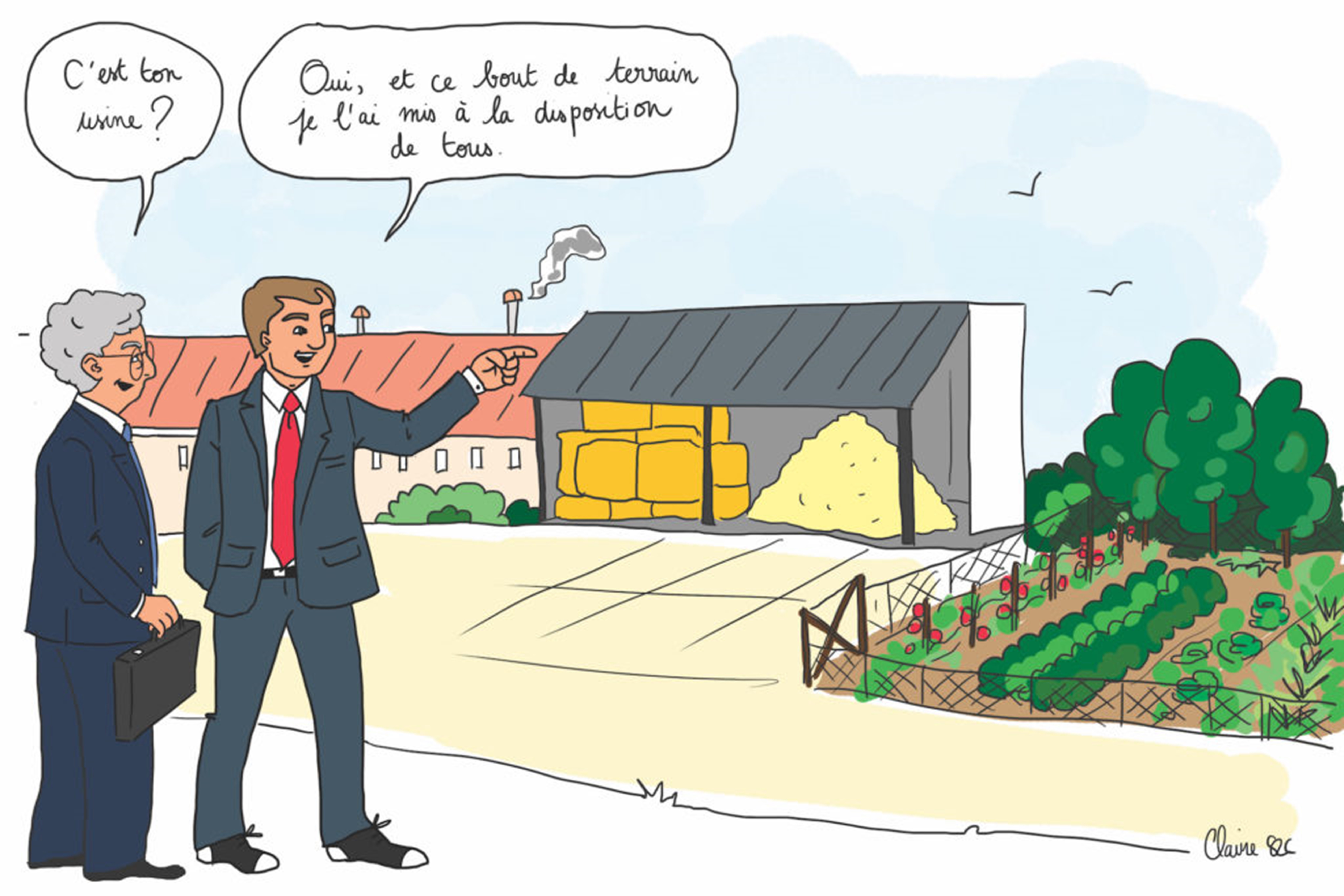
Ce principe se fonde sur le fait que la terre a été donnée en gestion à Adam, c’est-à-dire aux hommes.[2] À tous les hommes la terre est un bien commun.
Il faut éviter de confondre cette notion avec celle d’intérêt général.
Laura Rizzerio, professeur de philosophie à l’Université de Namur, nous explique la différence :
« En lisant Aristote, on peut dire que l’intérêt général reste lié à ce qui est de l’ordre de l’utilitaire, et à la somme des intérêts particulier. Le bien commun — qui doit être recherché par le politique, dit Aristote — dépasse la seule recherche des besoins essentiels. Il a pour objet d’offrir un cadre sociétal qui donne à l’homme le moyen de pouvoir accéder à la plénitude de son humanité et de sa liberté. »[3]
Toujours en référence à Aristote, elle désigne comme biens communs, comme éléments du « cadre sociétal » nécessaire à la croissance de la personne humaine : la paix, la sécurité et l’amitié. Elle ajoute, sensible à l’actualité marquée par les manifestations de collégiens en faveur de l’environnement que la terre est un bien commun. Nous pourrions aussi rappeler que nous avons un autre bien commun fondamental qui est notre humanité, notre nature humaine, à développer et respecter.
Par contre, Laurent de Briey ne fait pas la distinction soulignée :
« La recherche du bien commun », c’est « la recherche collective de l’intérêt général ». Les valeurs communes sont nécessaires mais leur choix « relève de l’autonomie collective ». « Seule la discussion démocratique doit déterminer les valeurs adoptées par la communauté. L’autonomie collective n’implique pas la promotion d’un ensemble de valeurs propres à une tradition culturelle ou religieuse particulière. C’est au débat politique qu’il revient de déterminer les valeurs dans lesquelles la communauté se reconnaît. Cela n’exclut pas, cependant, que des valeurs inspirées par des convictions religieuses soient défendues par certains au sein de ce débat. »[4]
Allons-nous vivre ensemble dans la diversité, sous la loi, le règlement que nous aurons choisi ou que l’on nous aura imposé ou bien chercherons-nous à vivre ensemble selon le bien, un bien commun, en tout cas selon notre bien commun le plus fondamental : notre humanité, substrat de biens communs plus spécifiques ?
Au lieu d’accepter que nos volontés se heurtent et que s’ensuivent des luttes continuelles ou récurrentes, il nous est proposé d’envisager les rapports humains sur le modèle des rapports entre l’homme et la femme qui renoncent à une partie de leur bien personnel en vue d’un bien commun supérieur, en l’occurrence l’enfant.[5]
Nous sommes tous différents et parfois même très différents par notre tempérament, notre culture, notre philosophie ou notre religion mais aussi différent que soit l’autre, il y aura toujours un bien objectif auquel il sera attaché aussi bien que moi : une œuvre commune, un souci de sécurité, un besoin de reconnaissance, de bien-être psychologique ou matériel, un « cadre sociétal » adapté qui permette à chacun de croître en humanité, etc…
Notre époque très tourmentée et qui est, semble-t-il, toujours en crise semble nous offrir une belle opportunité pour vivre ces principes notamment dans les relations de travail et, d’une manière plus générale, dans le monde économique.
C’est du moins le souci de cette chercheuse uruguayenne[6] qui enseigne actuellement en France : Elena Lasida, auteur, entre autres d’un livre au titre significatif : Le goût de l’autre, la crise, une chance pour réinventer le lien.[7] Elle écrit :
« Dans les relations marchandes, le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à l’intérieur de l’activité économique normale. »
« L’économie n’a pas pour but la satisfaction des besoins, mais le développement de la capacité créatrice de l’humain. »
Mais de quoi l’homme a-t-il vraiment besoin, de quoi a-t-il soif ? Elle répond que la vraie autonomie n’est pas l’individualisme mais l’interdépendance : « l’identité est toujours une histoire de rencontre ».

Il faut remplacer le contrat par l’alliance et favoriser l’échange plutôt que le transfert pour « une économie au service du savoir-vivre plutôt que du savoir-faire, du bien-être ensemble plutôt que de la prospérité partagée ».
